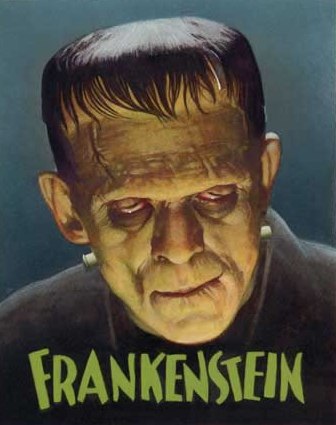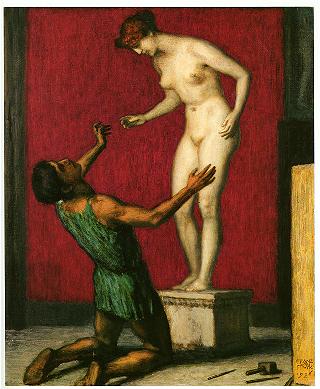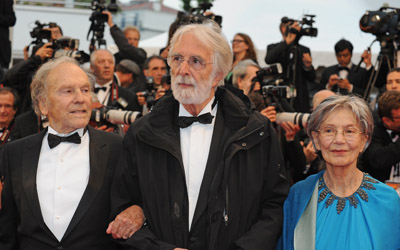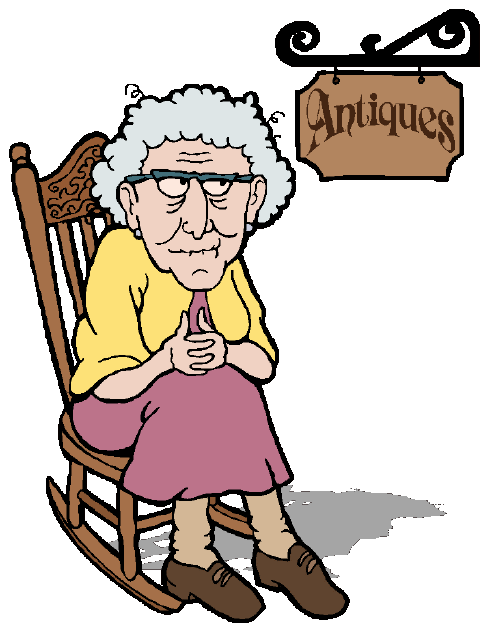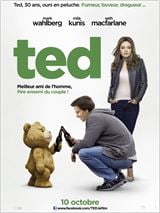Après « The Dark Knight Rises »
cet été, ou encore « Skyfall » la semaine passée, le
film aux allures de « retour aux sources » a décidément
la côte à Hollywood ces temps ci. Ce n'est pas « Frankenweenie »,
adaptation stop-motion noir et blanc et en long-métrage du court
éponyme de 1984, tous deux réalisés par Tim Burton, qui dira le
contraire.
Et si le « grand enfant »
Burton n'a jamais été autant décrié ces dernières années, la
faute à ses dernières moutures (« Alice au pays des merveilles » et « Dark Shadows » en première
ligne), jugées de moins en moins artistiquement créatives et de
plus en plus mercantiles, ce « Frankeenweenie », vendu
comme l'anti-Disney d'Halloween, devrait pouvoir réconcilier tout le
monde, y compris les plus récalcitrants.
Synopsis : Victor
Frankenstein, jeune garçon solitaire, passe la plupart de son temps
auprès de son meilleur ami, son chien « Sparky ». Et
lorsque ce dernier décède brutalement, victime d'un malencontreux
accident de la voie publique, c'est le monde tout entier de Victor
qui s'effondre.
Le deuil s'avérant impossible, Victor
décide alors de le ressusciter, quitte à employer de terrifiantes
techniques scientifiques et bouleverser ainsi l'équilibre de la
paisible ville dans laquelle il vit.
Même si, suite au succès phénoménal
et planétaire de « Charlie et la chocolaterie », Tim Burton est quasiment devenu une marque de fabrique, on ne
peut nier que le loufoque metteur en scène américain a toujours su
conserver un talent pour s'embarquer dans les projets fous, des
projets dotés à chaque nouvel opus d'un univers unique en son
genre : identification du génie.
« Frankenweenie » ne déroge
certainement pas à la règle, nous entraînant dans un voyage
schizoïde et fantasque, habité d'une galerie superbement horrifique
et originale de personnages doublés par des habitués de Burton
(Catherien O'Hara, Winona Ryder …), tous plus géniaux les uns que les autres (mention spéciale au professeur de sciences, diablement bien doublé par Martin Landau).
Techniquement parfait (quelle bonne
idée d'avoir penser au noir et blanc, chapeau également pour la
conversion chair et os / pâte à modeler …), « Frankenweenie »
est une aventure à la fois touchante, tendre et poilante, pour les petits et
les plus grands, conçue en forme d'hommage (bien vu d'ailleurs le
clin d'oeil chez les morts à Mary Shelley).
Le conteur Burton, fidèle à ses
mythes, replonge aux sources et nous livre du minerai de ses débuts.
Un véritable défilé de ses obsessions à l'écran : lieux de
prédilection (pavillon banlieusard, moulin, cimetière, fête
foraine), figures emblématiques (maire grognon, canidé bien
pensant, monstres à gogo), thèmes récurrents (les affres et bonheurs de la création,
histoire d'amour entre héros marginal et fille gothique) ... sacré
Tim, quelle chance ils ont ceux qui t'approchent !
Bilan : décidément, l'«
Étrange » a de beaux jours devant lui avec Burton aux
commandes. Cette déclaration d'amour au cinéma de genre qu'est
« Frankenweenie » en est bien la preuve.
La Bande Annonce de Frankenweenie:
NOTE: 9/10